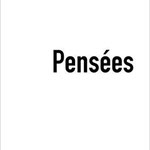- Ewin Blumenfeld au jeu de Paume . Pour jouer?
- America Latina à la Fondation Cartier pour l'Art Contemporain
- Zeng Fhanzi au MAM de la Ville de Paris
- Sergio Larrain à la Fondation Henri Cartier Bresson
- Poliakoff
- Salgado à la MEP
Ewin Blumenfeld au Jeu de Paume. Pour jouer?

Alors là, très vite. C’est montré au jeu de Paume. Bon. En général, ils savent ce qu’ils font. Mais voilà la difficulté : à force de montrer des artistes et des artistes et des artistes, ils finissent par caler. L’énorme désavantage compétitif de la photographie sur la peinture se trouve dans la durée. La photo c’est très, très jeune à l’aune de l’humanité pensante et créante. La peinture, elle, on sait qu’elle remonte au moins aux Romains et, peut-être aux Grecs, (en général, ce que les Grecs faisaient bien était repris par les Romains) pour ce qui concerne la peinture sur supports mobiles, ceux que nous nommons « tableaux » par opposition à « fresques ». Bien sûr, cette peinture est tombée dans l’oubli. Je suis sûr que peu de gens ont une idée des œuvres de Caïus Fabius Pictor. Il n’y a pas que ce peintre qui ait été victime de la désaffection du public amateur. Les œuvres de Thomas Couture ont subi le même triste sort. C’est dire cependant qu’il n’y a pas pénurie de « produits » (comme on dit maintenant que les principes de Business administration ont envahi les écoles de formation des conservateurs de musée).
Donc, de toute évidence, quand un musée de peinture veut jouer son rôle de montreur d’art, même s’il est limité par une spécialisation et pour autant que celle-ci ne s’écrive pas « toute la peinture de l’année 1882 », il n’a pas de difficulté d’approvisionnement. Les patrons de musée de peinture peuvent rater des expositions, ils peuvent n’être pas exhaustifs, ils ne peuvent pas manquer de matière.
Ce n’est pas le cas pour la photographie dont les premières manifestations datent d’un peu plus de 150 ans. Une goutte d’eau dans l’océan de l’art. Ceci pour expliquer que, les cimaises devant être remplies, le personnel devant être employé, les abonnés devant être comblés, la garde qualitative est parfois baissée et l’exposition n’est pas convaincante du tout. C’est très exactement ce qui vient de se passer avec l’exposition qui rassemble des œuvres « jusque-là, pas exposées » d’Ewin Blumenfeld.
L’intéressé n’a pas commencé « photographe ». Né à Berlin, il s’est d’abord essayé à des tas de choses artistiques avant de trouver sa voie « photographique ». L’exposition montre qu’il a été « dada » ou « dadaïste ». Avec des collages (difficile d’être Dada sans collage). Il y aussi des tableaux qui montre bien la dérision dans laquelle il tenait la peinture « traditionnelle ». Ce n’est pas là où il se montre le meilleur. Pour dire le vrai, ils sont rares ceux qui ont bien fait dans le Dadaïsme, le Suprématisme, le Surréalisme. Encore plus rare lorsqu’ils se livraient au collage. Arrivé à Paris après les Pays-Bas, il découvre la photographie et en fait son métier.
Il sera toute sa vie photographe de Mode chez les plus grands éditeurs de magazines… Vogue, Look, Life, Coronet, Cosmopolitan. Il y développera un style tout à lui et dont on voit les exemples sur les cimaises du Jeu de Paume. Et aussi, il fera des photos de personnes : des portraits. On nous dit que ce n’est pas l’apparence qui compte pour lui mais la réalité derrière les apparences. Heureusement, il y a de l’apparence quand même. Du coup, il y a quelque chose dans les cadres. Des portraits de gens. Lisses comme il est difficile d’imaginer « lisse » ! Il a fait aussi des « nus ». Les photographes comme les sculpteurs grecs et romains font toujours des nus ! Il doit y avoir un lien subliminal entre eux.
Au fond, quand on y réfléchit bien, il a fait comme Helmut Newton, sauf qu’Helmut, l’a fait en beaucoup, beaucoup plus grand. Les nus d’Helmut sont monumentaux au sens que les Grecs et les Romains donnaient à ce terme. Ceux d’Ewin Blumenfeld reflètent la technologie de son temps : ce ne sont pas de grands nus. Rien à voir non plus avec les nus de taille modeste de Drtikol, Brassaî, Kertesz, Weston ou même Lucien Clergue…
Ewin Blumenfeld est donc un bon photographe comme il est nombre de bons pros’. C’est intéressant de voir comment il photographie. Il est de son temps. Cela donne une idée de ce temps-là. Comme il est intéressant de jeter un coup d’œil sur la grande peinture de la fin du XIXéme siécle ou sur les «peintres montmartrois».
Une chose qui est à mettre à son actif jusqu’à la fin des temps : sa photo d’Hitler. Elle fera le tour du Monde, récupérée par l’Armée Américaine en tant qu’instrument de propagande. Photo-choc, indéniablement forte.
America Latina à la Fondation Cartier pour l'Art Contemporain
Il y en a tant qui vont bientôt finir. Il ne me reste plus qu’à donner un coup de projecteur. Insuffisant. Désagréable pour les artistes. Tant pis.
La Fondation Cartier pour l’Art Contemporain expose l’Amérique Latine avec toutes les ambiguïtés attachées à ces expositions « 1960-2013 » qui rassemble le travail d’artistes pour les uns, de témoins pour les autres, de photojournalistes, ou de photographes attachés à la création pure, à la recherche des formes et de sens nouveaux.
Ambiguïtés inévitables puisque l’histoire de l’Amérique du Sud a été terriblement tourmentée, traversée par des dictatures militaires impitoyables, par des guerres civiles atroces, larvées et ouvertes. Nécessairement, une part non négligeable de l’exposition tourne autour du photographe, témoin et reporteur. Photos de cadavres, restes torturés, hommes abattus. Photos tirés de journaux d’opposition vite fermés ou interdits. Photos de combat.
Elles sont toutes intéressantes, passionnantes, émouvantes. Toutes les photos qui montrent que des hommes, des femmes et des enfants souffrent valent d’être montrées. Celles qui mettent en évidence qu’ils ont été tués, emprisonnés, torturés, sans savoir vraiment pourquoi, pour rien parfois, parce qu’ils étaient au mauvais endroit au mauvais moment. Et bien sûr, tous ceux qui sont morts pour une raison précise : ils ne voulaient pas courber la tête, ils voulaient que des tyrannies cessent, qu’un monde meilleur émerge enfin. Toutes ces photos doivent être vues, revues, au même titre que doivent être vus et revus les documents sur les massacres nazis, toutes les horreurs biafraises, rwandaise, tchétchènes…. Les photos exposées à la Fondation Cartier venant d’Amérique latine sont des témoignages au sein de l’ensemble des témoignages.
Mais, il n’y a pas que les photos de témoignages brésiliennes, chiliennes, boliviennes, argentines etc… La Fondation expose aussi des travaux photographiques au plein sens artistique. L’ambiguïté est là. Beaucoup de ces travaux sont passionnants, sans pour autant qu’on ait envie d’y trouver des témoignages politiques ou moraux… Comme il fallait de la place pour les témoignages…
Comme il s’agit d’un rassemblement de plusieurs artistes, comme parfois, une seule photo est exposée, il est difficile de parler d’œuvres émergeant à la façon des Icebergs. On a retenu des noms. Des auteurs qui marquent. Des photos très fortes. Universelles. Miguel Rio-Branco, Francis Alys, Paolo Gasparini, Antonio Manuel, Annabella Geiger, Elias Adasme, Pablo Ortiz Monasterio.
Zeng Fhanzi au MAM de la Ville de Paris
Question : les musées occidentaux et parmi eux les français, se livrent-ils à une course à l’artiste chinois ? Ont-ils un « revenez-y » de la peur de rater ? Comme pendant des dizaines d’années, les critiques français et européens après s’être mordu les doigts pour n’avoir pas reconnu les impressionnistes, s’efforcèrent de « chasser » tous les futurs grands artistes. On s’était habitué aux Chinois abstraits, recherchant toujours chez eux, les quelques traces de coups de pinceaux qui rappelleraient la tradition avec ses montagnes floutées dans de vastes nappes de brouillard. On les aimait bien ces Chinois qui peignaient comme des occidentaux. Et il est vrai qu’un peintre abstrait, justement, se définit par rien de concret. On ne reconnaissait pas grand-chose si ce n’est son abstraction. Donc si Chinois il y avait, on ne le voyait pas. On prenait le risque du « Chinois » qu'on modérait par « l’abstrait ». Ce n’était pas vraiment faire un pari sur un saut dans l’inconnu ! Mais, pensant toujours aux impressionnistes qu'on avait ratés, on se disait qu'au moins on avait placé un jeton sur quelque chose de nouveau, mais sans prendre trop de risques...
Ce n’est pas du tout la même chose avec les « Nouveaux Peintres Chinois ». Je les appelle comme ça parce que je ne suis pas très savant en peinture chinoise. J’avais chroniqué l’exposition de quelques œuvres de Ye Minjun à la fondation Cartier pour l’Art contemporain. J’avais été très impressionné par un travail novateur et dur. Et pas abstrait pour un sou: même si on ne veut pas le voir, c’est de la peinture chinoise. Même sentiment pour les œuvres de Zhang Xiaogang. Les musées occidentaux ne veulent pas rater les Nouveaux Chinois: les expositions montrent chaque année, davantage de travaux, de peintures, de sculptures de cette nouvelle école Chinoise née des décombres des diverses révolutions culturelles ou autres, et mettent en valeur, une création solide, forte, originale où l’expressivité s’écarte des standards occidentaux, où la violence ne s’exprime pas en stridences de formes, de couleurs ou de matières à l'allemande. La présentation des œuvres de Zeng Fhanzi est un moment très intéressant de la recherche des jalons marquants de cette nouvelle peinture qui trace son chemin entre refus de la tradition, écarts violents par rapport aux formes européennes et tailles gigantesques «à l’américaine».
C’est ainsi que les tableaux de Zeng Fhanzi, tels qu’ils nous sont montrés, relèvent plus de l’art en train de se faire que de l’œuvre accomplie. L’artiste n’est pas un gamin. 50 ans. Son « métier » est bien forgé et sûr. Les premières œuvres montrées sont dans la lignée des Lüperz et Beckmann puis évoluent vers les représentations chinoises qui nous deviennent classiques de personnages « aux masques ». De même que les personnages de Ye Minjun sourient de mille dents quoiqu’il leur arrive, de même Zeng Fhanzi les affuble-t-il de masques destinés à exprimer des sentiments ou des opinions au lieu et place des visages qui, soit en sont devenus incapables, soit se le sont vus interdire. Dans ces séries un magnifique autoportrait au cheval d’enfant et aux ombres antagonistes ! Puis rupture encore, dernière manière de l’artiste, ou avant-dernière, ou … peu importe. Y domine une peinture de broussailles pareilles à des champs de fils de fer barbelé. Derrière les broussailles, couleurs, lumière, clarté, animaux. Broussailles « anti-drippings » à la Pollock, tout survient dans un esprit de construction méticuleux. Certains de ces entrelacs de couleurs feraient penser à de lointains Nymphéas ? Autant ces dernières sont un appel à venir s’immerger autant les entrelacs du Chinois sont un avertissement lancé à ceux qui s’imagineraient qu’on peut le faire en toute simplicité.
Une œuvre, la dernière semble-t-il, inachevée, gigantesque, sortie tout droit de l’atelier de l’artiste, donne une idée de cette violence contenue dans un rêve fait de lianes et des ronces multicolores, dangereusement emmêlées.
Passionnant.
Vite 4: Sergio Larrain à la Fondation Henri Cartier Bresson

Photographe chilien, remarqué par Cartier Bresson, il est « naturellement » exposé à la Fondation HCB. La notice qui est remise à l’entrée de l’exposition indique « il laisse une œuvre brillante, telle une météorite, dont il eut la sagesse d’interrompre la course, qui ne lui laissait plus la liberté attendue »… On est tenté de commenter comme il est d’usage devant des propos aussi définitifs : « c’est beau comme l’antique ! ». Sauf que « la sagesse d’interrompre… » : Sergio Larrain est mort en 2012, curieux épitaphe.
Les photos rassemblées à la Fondation doivent-elles être considérées comme il est d’usage dans les rétrospectives : en silence, méditativement, dans une posture entre messe solennelle et mise au tombeau ? Avant oubliettes ? Ou bien, peut-on se laisser aller à un regard critique, comme si l’auteur était encore vivant, comme s’il avait encore quelque chose à faire, à dire, des photographies à montrer ?
On prendra ici la deuxième posture : le regard intéressé et critique. Sergio Larrain a commis une photo emblématique. Ce genre de photo qui dit tout d’un auteur ou d’une œuvre : les deux petites filles vues de dos, descendant un escalier à Valparaiso. Cette seule photo est un miracle d’équilibre dans la composition, de naturel et de sens entre rêve, réalité et mystère. Chilien, amoureux du Chili, celui de la rue, de la misère, des enfants abandonnés à eux-mêmes ou sans famille tout simplement, il a su mettre en valeur la lumière et l’ombre dont sont faits, le Chili, la Bolivie et le Pérou. C’est là que se trouvent ses plus belles photos, en noir et blanc, photos prises à la volée ou posées. Femmes boliviennes écrasées de lumière, paysages sculptés par l’ombre portée des montagnes.
Sergio Larrain sera tenté par l’Ancien Monde. Il découvrira Londres, puis Paris. Il sera photographe pour Magnum. Ce n’est pas un photographe de ces mondes-là. Si Londres l’a inspiré. Si la misère des banlieues anglaises lui a rappelé celle des villes chiliennes, il lui a, dans ces lieux-là, dans ces moments-là, manqué l’empathie naturelle spontanée qui donnait si bien dans l’univers des Andes et de leurs alentours. Ses photos de Paris montrent juste qu’il a dû aimer la ville et peut-être un peu ses habitants, qu’il y a cherché des choses, de la pauvreté, du malheur, des êtres en déshérence… Cela donne des photos sympathiques et bien faites. Bien loin des coups de force de ses photos sud-américaines.
Sensibles aux scènes de rues, de bordels, de nuit et de misère, Sergio Larrain, n’est cependant pas un photographe qui use du scalpel ou qui photographie à ses risques et périls. Il rend compte, sans goût apparent, des situations glauques ou les êtres entre-deux. Pour bien faire, il a besoin de l’intimité des lieux et des gens. Il capte les plus belles scènes avec les enfants, les femmes, les rues des villages, le soleil qui découpe au ciseau les scènes noir et blanc, vers lesquels il se porte naturellement, qu’il sait où trouver sans chercher. Chilien et « Andin », il est brillant lorsqu’il veut montrer le choc de l’homme et d’un monde cruellement lumineux. Ses photos touchent au plus fort et au plus beau.
Poliakoff
Salgado à la MEP
Poliakoff, chez Applicat-Prazan jusqu’au 21 décembre 2013.
J’ai écrit dans « un p’tit tour à la FIAC » : « Un dernier mot : Poliakoff ! L’homme qui avait trop lu Maurice Denis et ses histoires de « couleurs dans un certain ordre » etc…. Ennuyeux comme la pluie. C’est triste de voir partir en petits morceaux ou de s’effacer comme un joli souvenir qui ne fait plus surface, un « could be », un possible « grand de la peinture ». C’est ça la loi de l’évolution». (lire dans Mots d’Or)
Il faut que je me reprenne. J’ai été trop dur. J’ai ajouté :« Poliakoff restera quand même… ». Et d’abord : Poliakoff est-il un peintre abstrait ? Ça y est direz-vous, encore de la provocation ! C’est devenu compulsif. Peut-être un TOC ? Mais non, ce n’est pas là que je veux vous emmener. Je veux aller du côté de Rothko. Du côté des « ouvreurs de porte ». Les passeurs, ceux qui prennent les regardeurs, ouvrent leurs esprits, les fascinent et leur font voir, au-delà, ou en eux-mêmes, des mondes inconnus, nouveaux, occultés, enfermés derrière les barrières mentales qui permettent de fonctionner dans la vie quotidienne.
En ce sens l’obsession de Poliakoff, son style répétitif, les formes colorées qui s’emboîtent, ce puzzle apparemment sans image référente, qui donnent le sentiment d’avoir été conçus, dessinés, coloriés au hasard de l’inspiration, prennent leur vrai sens. Celui d’une invitation au regard intérieur, d’une méditation et, pourquoi pas, d’une prière. Tout ceci est très concret. Dire que les tableaux de Poliakoff contiennent quelque chose d’une icône serait-il faire trop cas de son origine russe ? Peu importe. Bien sûr, il n’y a pas d’icône ici, pas plus que chez Rothko on ne trouve ni Torah, ni architecture religieuse. Mais tout autant, chez l’un et chez l’autre, se retrouve un appel au voyage vers soi, vers l’essentiel, vers de nouveaux mondes.
Ces deux hommes sont des passeurs au même titre l’un que l’autre. Faut-il dans ces conditions établir des grades, des notations, des hiérarchies ? Certainement, pas si ce n’est que Poliakoff et ses Kaléidoscopes sont moins solides. Tous deux traitent de la lumière. Tous deux en appellent à elle sous toutes ses longueurs d’onde. Pourtant la lumière est, chez Poliakoff, le fait de sortes de collages quand chez Rothko, c’est de sculpture qu’il faudrait parler. La peinture de Poliakoff est concrète, matérielle, celle de Rothko montre une nuée, un gaz, des voiles et des gazes. Une dimension et un défi pictural en plus.
De belles photos ne font pas de la belle photographie.
Sebastião Salgado : Genesis. Maison européenne de la photographie. Jusqu’au 25 janvier 2014
C’est de la belle photographie que la Maison Européenne de la Photographie propose sur quasiment trois étages. Il y en a 254 (pourquoi pas 365 !). Ce sont de magnifiques photos de la nature avec de la mer et de la montagne et des rivières et des déserts et des steppes et de la banquise. La nature quoi !
Et aussi des animaux, des queues de baleine bleue qui battent la mer, des manchots empereurs qui s’élancent avec l’élégance qu’on leur connait dans les «flots glacés» de l’arctique, des singes. Et enfin, des humains dans leur humanité la plus naturelle, ces hommes qui vivent près de la nature et ne font qu’un avec elle, des femmes d’Amazonie nues alanguies sur leur nattes, des hommes vêtus de leurs étuis péniens, etc etc…
Atroce !
Insupportables belles photos qui montrent comme le beau, l’élégant et le charmant sortent de partout. On ne voit pas de loqueteux, on ne voit pas de gens en train de mourir de faim, on ne voit pas non plus de coupe-coupe sauf pour le type qui fraie le chemin au photographe. On voit de belles choses à voir, des images émotionnantes et qui vous bouleversent tellement c’est bô.
Absolument atroce.
On croirait entendre dans le lointain les flons-flons malheriens de « das Lied von der Erde ». A quand une nature qui sonnerait comme « Elektra », Lulu, « the screw » ?N’y a-t-il pas dans une exposition de 254 photos quelques-unes qui ne ressemblent pas à cette espèce de chant emersonnien-kitsch à la nature et aux gens qui vivent « selon la nature », en harmonie avec elle?
J’en ai trouvé. C’est pourquoi, « Vite », je rédige cette chronique.
Un léopard dans la vallée Barab, au bord d’un point d’eau, prêt à la détente. Seul point de lumière dans la nuit. La mort attend tranquillement sa proie. Végétation sur les pentes du volcan Mahabura : le douanier Rousseau n’avait pas rêvé. Vol de centaines de bec ouvert africains ; multitudes de points, autant d’oiseaux qui définissent une forme noire découpée sur fond de forme blanche, un nuage. Portrait d’homme au campement de bétail à Kei. Visage raviné, scarifié et sans regard. L’océan arctique gelé ; Munch, Vallotton, Spilliaert. Et aussi, dans le lointain, nageoire caudale d’une baleine dans un fjord. Le reflet dans l’eau, la dédouble et la fait papillon toutes ailes déployées pour frôler une eau limpide et tranquille.
Il y a aussi des occasions de rêver, penser, méditer. On trouve aussi des photos inspirées. Rares, hasardeuses. On peut aller voir pour cette quête. Il en est d’autres encore que je n’ai pas mentionnées.
A vous de continuer l’exploration. Et puis, si vous aimez, la nature et les bêtes, si vous aimez l’homme et la femme servis au naturel, vous ne serez pas déçus.
Comprendre le Métavers en 20 questions

Il vous suffira de tendre la main, vers les librairies du net,
Babelio, Amazon, Fnac, books.google, BOD librairie et l'éditeur: Arnaud Franel Editions
Quelques ouvrages de Pascal Ordonneau
Panthéon au Carré est disponible aux éditions de la Route de la Soie.
Promotion est disponible chez Numeriklivre et dans toutes les librairies "digitales"
Au Pays de l'Eau et des Dieux est disponible chez Jacques Flament Editeur ainsi que
La Désillusion, le retour de l'Empire allemand, le Bunker et "Survivre dans un monde de Cons".
"La bataille mondiale des matières premières", "le crédit à moyen et long terme" et "Les multinationales contre les Etats" sont épuisés.
En collaboration: Institut de l'Iconomie
S'inscrire
chaque semaine "La" newsletter (tous les lundis)
et "Humeur" (tous les jeudis)
Il vous suffit de transmettre vos coordonnées "Mel" à l'adresse suivante
pordonneau@gmail.com
 Pascal Ordonneau
Pascal Ordonneau