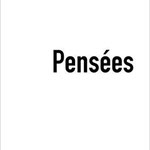Les grands bâteaux

Humeurs 82 : les commandes de mega-bateaux affluent vers les chantiers français.
Ce n’est pas une nouvelle : la France sait fabriquer des bateaux. Passons sur la petite armée des dériveurs, des bateaux à voile, avec pilotes et vents automatiques ou celle des bateaux à moteurs de toute taille avec jolies filles en proue et retraités à la barre. C’est connu et archi connu : nous sommes excellents dans la fabrication de ces bateaux.
Mais nous sommes aussi excellents pour fabriquer des bateaux-monde, ou des bateaux-villes, ou des bateaux-iles, enfin, des bateaux qui sont des univers : les gigantesques navires de croisière. Face à eux, tous les Concordia de la terre font barquasses. Nos chantiers croulent sous les commandes de ces bateaux. Quand les bateaux sont trop petits, ils savent en augmenter la taille : « enlarge your ship » est-il proposé dans les campagnes marketing des chantiers français.
Les bateaux kilométriques seraient pour bientôt ? Pourquoi pas ? Les tours ont lancé le défi. Des centaines de bateaux vont accueillir des milliers de femmes, d’hommes, leurs enfants, les restaurants qu’ils fréquentent, les coiffeurs qui les bichonnent, les music-halls et leurs danseurs, les salles de cinoche trois D … Le marché est considérable. Les menaces terroristes y ont leur part. A terre les risques pèsent trop lourds sur les touristes. Les grands navires constituent de bonnes protections : le « safe tourism » est en plein essor.
Bientôt des bateaux de 2000 ou 3000 mètres se succéderont guidés automatiquement, en longue files, les uns remontant (file de droite) l’Adriatique, ou la Méditerranée, ou ailleurs, les autres descendant (file de gauche) vers Venise, Miami ou Bangkok. Flotteront ainsi plus d’un million de touristes puis, assez vite, 10 millions, 50...
Dans le même moment une mutation industrielle se déploie dans le secret des grandes sociétés de tourisme maritime. On ne veut plus que les bateaux achèvent leur existence sur les rives du Bangladesh, de Mauritanie, ou d’ailleurs. Biodégradables, ils devront être employés jusqu’au bout du bout de leur durée de vie technique. Quitte à faire circuler des bateaux dépassés sur le plan technologique, quitte à ce que certains d’entre eux, très vieux, montrent des points de rouille et quelques rustines pour les faire tenir, quitte, enfin à ce qu’ils finissent dans quelques grandes fosses marines à bout de force et rongés par l’usure.
Cette mutation industrielle s’accompagnera d’un bouleversement marketing. Quels clients pour coller au cycle de vie de nos grands bateaux? Que faire des vieux bateaux sinon les remplir de vieux touristes à mobilité restreinte? Les navires ne feront plus d’escales. A quoi bon ? Dans les très vieux navires, les coursives serviront au personnel soignant. Et les bateaux qui ne tiennent qu’avec rustines et bouts de ficelle ? Ils stationneront immobiles avec leur cargaison de clients invalides dans la mer des sargasses ou toute autre mer utile à la reproduction des anguilles ou des araignées de mer. Ils stationneront le temps qu’il faudra, le temps que les rustines lâchent.
Et si, on laissait les garde-mangers voguer au fil de l’eau…

Le Costa bella, un beau cargo transformé en Bateau de croisière, se dirigeait vers les Seychelles.
« Le feu s'est déclaré lundi vers 9h40 dans la salle des générateurs où il a gravement endommagé les installations …Les générateurs ont été touchés et les hélices ne fonctionnent plus. Les batteries de secours fournissent encore de quoi éclairer mais la climatisation est coupée et les cuisines sans courant ». Les batteries de secours ont tenu une semaine. Elles sont mortes maintenant. Les nuits sont claires en cette saison. On a pu tenir.
Mes doigts tremblent. Depuis des jours, je lis et relis ces lignes. Photocopies distribuées par l’équipage. Transparence. Ordre de la compagnie. Vous devez savoir. Ne pas paniquer. Le bateau dérive sans danger. Pas de tempête ni de cyclone en vue. Mais la climatisation est coupée et les cuisines sans courant. Les secours ont lancé des vivres fraiches. Par hélicoptère. Sans électricité, plus de frigo. Pas de cuisson. Aliments avariés. Il n’y a plus d’eau non plus. Plus de douche. Pas d’électricité, pas de pompes pour monter l’eau dans les cabines. L’eau minérale a été épuisée, très vite. La chaleur. Plus de climatisation. Soif. Nous dérivons. Soif. Et faim, maintenant.
Le bout de papier dans mes mains. Je le relis. Ils vont venir. On l’a dit. Un hélicoptère est venu. Après plus rien. Ils ont dit qu’il n’y avait plus de papier. Mais, ils ne disent rien. Alors, on ne sait rien. Je m’accroche au papier. Au loin, la compagnie, les autorités, savent. Surement.
J’ai pris mon quart. Il faut être vigilant sans cesse. Ils peuvent revenir. Les types des cabines de premières sont les plus violents.
Une des femmes manque. Je me suis endormi ? Ils sont venus sans bruit. On l’a entendu hurler. D’un coup plus rien. Et puis l’odeur de viande. Salauds, ils font du feu. Ils savent que c’est interdit. Ils s’en foutent. Ne plus m’endormir. J’ai faim. J’ai très faim.
Nous dérivons. La mer partout. Rien d’autre. Personne. Ils devaient venir. Ils se sont perdus ? Rien et j’ai vraiment faim.
Et si, pendant des siècles quand les iles n’étaient pas désertes….
Il faut s’imaginer en indigène sur une île très loin de toutes les terres habitées. Un soir, alors que le soleil se couche, à l’Ouest, comme d’habitude. Après une longue journée de travail. Rêver. Il a fait si chaud. Dos encore endolori par les fardeaux et l’araire peut-être. Et aussi les voiles des bateaux affalées après la pèche. La peau irritée et les yeux rougis. Brûlures du soleil. Morsures du sel. Rêver. Il n’est plus temps de travailler. La nuit est là, bientôt. Il n’est pas encore temps de s’en aller vers le village. Regarder le soleil qui achève son voyage. Sourire de le voir répéter sa plongée dans l’eau calme. Plier les mains et les joindre pour lui rappeler le rendez-vous du matin. Et, dans les dernières lueurs, se lever sur la grève pour, en signe de respect, pour boire un peu de la mer qui entoure et pourrait menacer.
Votre pied, dans l’écume encore blanche, heurte un objet. Rêves et prières s’effacent alors. Vous vous penchez et vous ramassez un morceau de bois. Le soleil ne vous est plus d’aucune aide. Vous prenez ce bois pareil à une buche. C’est une buche en fait. Assez longue. Équarrie. Sans rugosités, ni aspérités. Lisse et polie. Vous la jetez sur votre épaule et sentez son poids. Le grain est serré. La fibre compacte.
Vous arrivez au village dans la case commune où les vieux sont réunis. Comme toujours, le soir, pour dire les mots qui inviteront le soleil à revenir. « A renaître » disent-ils. Pour que la lune, femelle jalouse, ne se laisse pas emporter par sa vindicte et le retienne confiné dans sa couche. Vous déposez, votre trouvaille au pied du plus vieux des vieux. Après l’avoir soulevé et pesé, il a caressé le bois, suivi du doigt ses irrégularités, gratté la fibre là où elle était la plus fragile. Il a alors souri. Puis, il l’a fait passer à tous les vieux du Cercle des Prières.
Et ils se sont mis à rire joyeusement. Ils ont ri en se frottant le ventre, la panse, l’estomac. Ils ont ri en faisant claquer leur bouche, en faisant grincer leurs dents. Ils se sont mis à roter comme on fait après un bon repas pour remercier les dieux et partager avec les esprits.
Alors, ils se sont retournés vers vous. Et vers les autres. Tous ceux qui participent au Cercle des Prières. Le plus âgé, encore très agile, s’est levé portant le bois au-dessus de sa tête et chantant que les Dieux n’ont pas oublié. Il a montré que le bois flotté était gravé. Il a passé son doigt à nouveau tout en lisant et en psalmodiant ce qu’il lisait. « Dans Deux Jours ».
Et si « Dans Deux Jours » les Dieux avaient voulu combler les hommes ?
Les vieux ont répété. Et chanté. Et psalmodié. « Dans Deux Jours ». Les calebasses, les tambours tendus de peau humaine, les fifres en forme de tibia ont été sortis. Ils ont rythmé le chant « Dans Deux Jours ». Ils ont joué avec les osselets sacrés. Ils ont sorti les crânes pour boire l’eau qui enchante.
Deux jours après, un radeau, nommé « Méduse », atterrissait avec son lot de victuailles. Viandes rougies à point. Certaines marinées, d’autres salées et, même, parfois, cuites sous le soleil et le vent combinés. Encore fraîche pour certaines pièces qui pouvaient même se déplacer toutes seules vers les poteaux culinaires. Quelques enfants, impertinence de la jeunesse, voulurent s’amuser à la bataille, opposant les javelots de leur initiation à un drôle de grand couteau rouillé mouliné sans force.
Les vieux assis en arc de cercle sur la plage, psalmodiaient « deux jours ont passé, les dieux n’ont qu’une parole ». Le mieux, on le sait, est d’abonder en remerciements. Les dieux sont capricieux.
Vous vous êtes amusé vous aussi de l’agitation autour du radeau, des enfants et de leur combat inégal, de toutes ces victuailles qui arrivaient à un moment propice.
Et vous avez murmuré « Méduse, pourquoi, Méduse ?».
Les habitants des îles les plus éloignées, perdues au fin fond des océans, à l’écart des terres habitées ont gardé cette tradition : attendre que les dieux améliorent leur régime alimentaire. Comme il faut que les faits de sociétés soient pensés et analysés, on les a surnommés cargo-cult. Avec une certaine pertinence. Cargaison et cargo… La référence au culte était aussi bienvenue. Les messages transmis par les bois flottés sont maintenant inscrits dans le ciel en traits d’un blanc nuageux. Plus souvent, les livraisons sont faites directement par les Dieux depuis le firmament. C’est, disent, ceux qui connaissent le monde moderne « sans intermédiaires ». La qualité gustative des produits s’en est ressentie. L’époque des livraisons en petite quantité est perdue maintenant. Les radeaux volants, ceux qu’ils appellent « Airbus » (« Méduse », a dit un ancien qui se souvenait des choses les plus anciennes, était plus joli) ne sont pas propices à une conservation selon les vieilles règles.
Les jeunes générations ne se rendent pas compte à quel point elles ont été bénies par nos dieux familiers. La tradition nous dit qu’il y a eu des temps heureux, des temps très anciens. Elle nous dit que quand le message nous était délivré, le village rayonnait. Lorsque la cargaison avait été livrée, les femmes riaient de bon cœur et s’encourageaient .C’était à celles d’entre elles qui retireraient le plus de cervelle, à celles qui sauraient découper un jarret en suivant parfaitement le sens de la fibre musculaire, en ne faisant pas s’échapper le sang, qui donne tant de goût à la viande dégustée fraîche ou donne du croquant lorsqu’on la cuit. C’était à qui saurait préparer, avec un rien de fiente d’oiseau et d’eau salée, un œil à gober ou un doigt à sucer avant le repas, pour donner de l’appétit.
Et si les Dieux ne savaient plus s’arrêter ?
Aujourd’hui, assis comme devaient le faire mes ancêtres, il y a très, très longtemps, rêvant, comme on ne peut pas ne pas rêver, lorsque le soleil retourne dans sa maison. Je ne cherche pas le bois flotté et le message qu’il va m’apporter. Il n’en vient plus. Ou s’il en vient, on ne les voit plus. Sur la plage, atterrissent par vagues, à de certains moments, des objets de toutes les couleurs, des boîtes en fer et des morceaux de tissus à moitié fondus. Le message est porté par les oiseaux qui se pressent au dessus de nos têtes. Si les oiseaux virevoltent sans cesse pendant une semaine, alors c’est le signal que les dieux nous envoient. Au loin, c’est une « méduse » d’un nouveau genre qui nous attend. Elle s’approche.
Celle-là vient de la grande Ile. Elle ne fume pas. Ils disent qu’elle est en panne. A la radio, les Dieux ont parlé de moteurs et d’électricité qui se sont arrêtés. Depuis une semaine cette « Méduse » suit les vents fidèlement. Ils disent que c’est une dérive. Mais en vérité, cette « Méduse » vient vers nous parce que les Dieux l’ont voulu. J’ai bien écouté. « Costa Allegra » ont dit les voix. Ils l’appellent aussi « paquebot de croisière ». Ils disent que c’est un cargo qu’on aurait déguisé en paquebot. Moi, j’ai compris que c’était un cargo, comme dans cargaison ou cargo-culte. Elle nous apporte un millier de victuailles dont environ 130 Français. Les jeunes ont ri de plaisir. Ils n’ont jamais goûté de Français.
Les Dieux semblent avoir perdu la mesure. Et nos jeunes en perdent leurs repères. C’est le troisième bateau qui nous arrive ainsi en un mois. Nos femmes n’en peuvent plus. C’est beaucoup de travail pour elles. C’est aussi beaucoup trop de nourritures pour nous. Bien sûr, il faut prévoir. « Les Dieux sont capricieux ». Alors, on fait des conserves et des bocaux. Et puis, avec le soleil, le vent et les embruns qui apportent le sel, la viande sèche vite. Je fais confiance à nos femmes. La précédente livraison comportait deux mille têtes. Elles ont fait des prouesses. Elles ont gagné une vraie bataille pour que rien ne soit perdu.
Mais je suis inquiet pour l’avenir. Je crois nos Dieux sages. Nous les connaissons depuis si longtemps. Je crains, en revanche, que les autres dieux le soient moins. On dit qu’il y a de plus en plus de cargaisons sur la mer. Presqu’autant dans le ciel. On dit que les autres dieux y chargeraient des vieux. De plus en plus de vieux. On dit que les bateaux seraient laissés sur la mer pour que nous autres puissions nous rassasier. Des centaines de « méduses » errant à la recherche d’estomacs à remplir.
Trop c’est déjà beaucoup. Assis sur la grève, regardant la lune blanche de colère contre notre soleil fanfaron, j’implore les dieux. Ils m’écouteront. J’en suis sûr. Je leur dis que les vieux, ça ne nourrit pas. La peau sur les os. Et pas de la première qualité.
Et si, le Concordia, c’était la faute à Fellini ?
Il ne s’agit pas d’humour ici. Ni de provocation. Il y a eu des morts. Un bateau quasiment sabordé. Une catastrophe pure et simple.
Pourtant, il y a aussi quelque chose d’étrange dans ce naufrage, dans les causes misérables et ridicules qui sont à son origine. Plusieurs choses étranges même, en creusant un peu la catastrophe, les circonstances et cette croisière.
Et si le bateau d’Amarcord…
Ce n’est pas la faute de Fellini. On a écrit ça pour provoquer, pour faire lire le papier. Fellini n’y peu rien. Amarcord ? Ce serait sa faute parce qu’il aurait filmé Amarcord ? Ce serait Le Bateau, dont Fellini fit un héros de légende. Le bateau, on disait Paquebot à cette époque encore, que Fellini met en scène, qui fait une courte apparition et qui s’en va laissant derrière lui, des cœurs songeurs, mélancoliques et amers.
Pris sous cet angle, ne pourrait-on pas opiner gravement et se proposer à soi-même la méditation qui suit « et si le bateau d’Amarcord n’était qu’un symptôme, sinon un syndrome ». On ne porte pas de jugement de valeur à cet instant. On dit simplement qu’il y a des indices troublants. Il y a ce rapport d’attirance mutuelle entre le bateau et la côte. Entre les passagers du bateau et les habitants des ports, villages et villes qu’écrasent la taille et la prestance du bateau. On dira après qu’il y a des différences. Mais sur le plan immédiat ? Dans les deux cas, les deux bateaux, le Concordia et le Paquebot de Fellini manœuvrent à quelques encablures de la côte, intentionnellement. Chacun des bateaux naviguent au risque des « cailloux », dans la nuit.
En disant « chacun », on occulte le fait que le bateau de Fellini trace sa voie au fil de la côte des dizaines d’années auparavant. Le film a eu un grand succès. L’image du Paquebot, illuminé de pied en cap, de proue en poupe, sans aucune autre raison, peut-être, que l’Incino, la révérence, ce salut des marins à la terre-mère, à leur pays aussi et à tous leurs proches. Alors, peut-être faudra-t-il se souvenir que le Capitaine du Concordia, tout petit, nourrissait une passion pour Fellini et surtout pour ce film Amarcord, où toute une ville se rue sur des canots, des dinghy, tout ce qui peut flotter pour répondre à l’Incino et sentir le monstre marin qui passe, altier et lointain et pourtant, si prés, si proche.
Il faudra beaucoup de séance de psychanalyse pour que le commandant parvienne à extirper de son subconscient, l’histoire que nous suggérons, pour la rendre plausible, pour qu’on veuille bien s’intéresser à ce léger trouble de la mémoire et des émotions qui fit trembler sa main, imperceptiblement, donnant un quart de degré de trop au gouvernail, effaçant ainsi quelques centimètres entre les rochers de la côte et la coque du bateau. Fatals centimètres.
Et si Amarcord était un paradigme ?
Alors, les choses, même les plus impensables s’expliqueraient ? Quelles choses ? Comment se peut-il qu’on reste là les bras ballant à regarder ce bateau, qui lentement s’affale et se couche comme un monstre gigantesque venu mourir en des lieux familiers. Doit-on se laisser aller à des rêves affolants où, leurs commandants ayant été vaporisés par les esprits mauvais venus du fin fond de la galaxie ou des tréfonds des abysses, les bateaux monstrueux, s’en vont tous au plus court vers les côtes les plus proches, pour s’enliser, s’ensabler et s’échouer et, dans un long barrissement lancé de leurs sirènes et de leurs cornes de brume, s’affaler et s’éteindre.
Que vient faire Amarcord et son Paquebot dans une histoire qui ferait penser au « cimetière des baleines » ? Tournons plutôt nos regards vers cette fascination étrange que l’homme sur l’eau entretient avec l’homme sur la terre, entre la côte et le marin. Pensons le bateau de Fellini en cherchant des mots et des idées simples. Il passe, mais il ne passe pas inaperçu. Il s’en vient mais pour mieux s’en aller. Il étincelle, mais il n’éclaire pas sa route. Il se donne donc à voir, mais ne se laisse pas contempler. Il est déjà loin quand on a réussi à s’en approcher.
Ce qu’on vient de décrire est un rêve. Écoutons-les écouter ce rêve, tous ceux-là qui sont venus sur d’impossibles esquifs, au risque d’être précipités dans les eaux glacées, pour sentir, humer et accompagner ce bateau qui les frôle. Ils s’approchent si prés que leurs parviennent quelques notes de valse, des tintements de cristaux et de couverts en argent et les rires perlés des femmes simplement vêtues d’or et de diamants. Le bruit des vagues se fait discret. Le vent retient son souffle. Ils tendent l’oreille au monstre illuminé qui passe si près, et s’en va, dans le lointain. Peut-être dans l’obscurité du bastingage, au milieu des guirlandes électriques qui sèment sur l’écume une poussière d’éclats jaunes, rouges et bleus, quelques ombres fluides et élancées se sont penchées sur la mer, laissant flotter leurs regards distraits au-dessus des minuscules embarcations, pareilles aux insectes insubmersibles à la surface des étangs, frêles et imperceptibles.
Ainsi Fellini a-t-il livré aux regards du monde, à notre regard, que les hommes peuvent se retirer du monde en d’autres lieux que les cellules des moines. Ils passent si prés de nous ces grands bateaux, pour nous appeler à vivre la vie des rêves. Ils passent si prés, aussi, pour que plongés dans des rêves, les passagers se souviennent un instant d’où ils viennent et s’en retournent vers une table de baccarat, de black jack, ou se préparent pour le gala du commandant.
Le Concordia serait alors une des expressions de ce paradigme : il faut passer au plus prés des côtes, car la retraite des hommes au sein d’une vie rêvée exige un référencement : celui de la triste réalité, celui de la vie de tous les jours qui sont le lot des habitants de la terre ferme.
Et si, les bateaux de croisière, n’étaient qu’une forme horizontale de la vie rêvée ?
Est-on enfermé dans un bateau de croisière ? La vie rêvée est-elle une prison ? Ils atterrissent pourtant et passent si prés des côtes ! Peut-être dans un retournement étrange, la vie rêvée des grands bateaux est-elle en passe de devenir la vraie vie, celle qui vaut d’être vécue. L’autre vie celle qui mérite bien peu serait laissée aux vivants du dehors, des côtes, des rues et des ruelles de toutes les villes qui s’étalent à plat, sur la terre comme des flaques d’eau, d’huile ou de boue aux contours informes. Car, les bateaux gigantesques, villes flottantes, qui vont et viennent sur les mers, les détroits et entre les ports, ont maintenant leurs émules… ou leurs concurrents, ancrés profondément dans la terre, arrimées pour y demeurer.
A quoi sert en effet, de déployer toutes ces flottes, ces bateaux luxueux, ces objets illuminés errant le long des côtes et scrutant les brumes au son d’un tango et du choc cristallin d’un glaçon dans un verre d’eau pure. Pourquoi ne pas les figer et interrompre leurs dangereux périples. Ils seront bientôt, si on laisse faire, des milliers qui croiseront en file indienne, au prés des côtes. Ils seront vus en troupeaux, transhumant à de certaines périodes, passant les détroits comme, avant l’hiver, les rennes, en chemin vers le sud, traversent les gués. Un jour, ils devront s’arrêter faute d’espace pour se mouvoir. Ils seront si grands, si vastes, comme des villes.
Qu’est-ce qu’une tour à Dubaï, dans les Emirats ? Qu’est-ce qu’une tour à Séoul ou à Shanghai ? Un bâtiment si haut ? Un objet qui brille de mille feux. Bâtis pour accueillir la lumière du jour et la renvoyer magnifiée. Conçu pour illuminer la nuit et réinventer les dimensions qu’elle efface. Les grandes tours rivalisent entre elles et défient les désordres de la vie d’en-cas. Elles opposent l’ordre et la précision des rêves qui s’incarnent à la vie erratique des cités qui se déploient comme se multiplient les cellules cancéreuses.
Plantées comme des arbres et bloquant la course des nuages, immobiles comme le deviendront les grands paquebots, les grandes tours kilométriques, abriteront music-halls, salles de bal, grands restaurants et centres commerciaux. Les piscines y seront des mers. Sur les terrasses, protégées des vents d’altitude, découpées par les illuminations écologiques, penchées vers les terres obscures, des silhouettes élancées, laisseront leurs regards s’attarder sur la vie d’en-bas, pour se porter enfin sur des horizons anonymes.
Au pied des tours, une foule, agglutinée venue par toutes sortes de moyens de transport, vélos, bus, tchuk-tchuk, pareils à une flottille d’objets minuscules, s’approchera des portes formidables, comme autrefois, on voulait rêver au passage des grands paquebots.
Et lorsque, un jour, enfin, les tours seront prêtes, pourront s’en aller les bateaux gigantesques. Ils iront se coucher sur des côtes italiennes, sur des rochers dans les Antilles ou sur les plages ensoleillées dans les eaux du pacifiques, répétant la fin du Concordia, avant que de s’abimer dans les grands fonds.
Le dernier de l’espèce, au moment d’être englouti, laissera échapper doucement ces derniers mots : « je me souviens ». Et si Fellini avait, dans tout cela, une part de responsabilités.
Comprendre le Métavers en 20 questions

Il vous suffira de tendre la main, vers les librairies du net,
Babelio, Amazon, Fnac, books.google, BOD librairie et l'éditeur: Arnaud Franel Editions
Quelques ouvrages de Pascal Ordonneau
Panthéon au Carré est disponible aux éditions de la Route de la Soie.
Promotion est disponible chez Numeriklivre et dans toutes les librairies "digitales"
Au Pays de l'Eau et des Dieux est disponible chez Jacques Flament Editeur ainsi que
La Désillusion, le retour de l'Empire allemand, le Bunker et "Survivre dans un monde de Cons".
"La bataille mondiale des matières premières", "le crédit à moyen et long terme" et "Les multinationales contre les Etats" sont épuisés.
En collaboration: Institut de l'Iconomie
S'inscrire
chaque semaine "La" newsletter (tous les lundis)
et "Humeur" (tous les jeudis)
Il vous suffit de transmettre vos coordonnées "Mel" à l'adresse suivante
pordonneau@gmail.com
 Pascal Ordonneau
Pascal Ordonneau