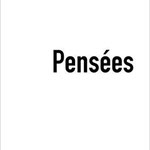Soliloques sur le Vaste Monde, Avril 2020
La mort est-elle une maladie?

Ainsi, le temps de la parole prise ou déprise, devient de plus en plus le jeu des exigences que les sociétés occidentales modernes, ont créé. Le jeu des « j’ai droit », des « tout de suite », et le pire de ces jeux, celui des « on me cache ». Pour avoir éradiqué le temps et donné droit de cité à l’instant, pour avoir répondu présent aux milliers de sollicitations immédiates, « sans attendre », rendues possibles par les réseaux, on a effacé les souvenirs et magnifié les temps présents. Le souvenir nous renvoyait au temps d’avant et lui offrait de revivre un peu, la suprématie de l’instant transforme les souvenirs en flashes, l’un dégageant l’autre et le sortant définitivement du jeu. L’instant, le « tout de suite », interdisent, et le moment de la réflexion et celui de l’ordre dans l’action.
Il est très instructif de voir nos grands journaux découvrir que les pandémies ont eu des « autrefois ». Ils vont chercher, et trouvent quelque fois, des manchettes qui les mentionnent. Reconnaissons qu’Il y a du mérite à fouiller dans la presse du passé des informations sur des sujets qui ne mobilisaient absolument personne, il y a près de 40 ans. Et dans la foulée, puisque l’épidémie de grippe de 1957, celle de 1969, puis encore celle de 1983, n’appelaient aucun commentaire, il est miraculeux d’extraire quelques bribes sur des non-événements dans des amas d’archives poussiéreuses.
Je dois battre ma coulpe : je n’ai aucun souvenir de ces moments où les épidémies tuaient par milliers et pourtant j’ai applaudi à l’Huluberlu, cette pièce d’Anouilh où Paul Meurisse, s’indignait qu’on ne s’intéressât aux morts qu’à partir d’un certain nombre critique. Ces dizaines de milliers de morts n’avaient-ils donc aucune importance ? Ou bien, notre conscience s’est-elle réveillée ? En 1957, La IVème se mourrait. Cette victime d’une mystérieuse épidémie démocratique nous souciait plus alors que les victimes d’une épidémie. En 1969, le vrai sujet n’était-il pas de lancer « la nouvelle société » avec Chaban-Delmas ? Alors, les 15 ou 20 000 morts de l’épidémie de grippe…
Doit-on en conclure que personne ne se passionnait pour ces « accidents » naturels ? Ne faudrait-il pas plutôt penser qu’entre-temps, les sciences nous ont habitué à des combats victorieux contre la maladie genre Blitzkrieg ou charge de la cavalerie à Eylau ? La mort n’était pas la maladie fatale qu’elle est devenue. La vie, n’était pas encore la vraie preuve que nous ne sommes pas morts ?
Aujourd’hui, le lieu de la mort est la preuve ultime que la mort est une maladie qui a mal tourné : on meurt à l’hôpital. On s’y est réfugié ou on nous y a posé pour que nous en guérissions. Car c’est de maladie qu’on souffre. On nous y a posé même si l’hôpital, en cette « douloureuse circonstance », ne peut rien soigner. « … quand il reste une chance ». Ne pas l’essayer, serait une faute.
L’hôpital gère des flux de vie, on ne peut pas y rester : Il faut le quitter le plus vite possible. Dans l’Ehpad on gère des stocks de vie. L’Ehpad est le sous-produit du droit imprescriptible à vivre, jusqu’au bout. Comme le sportif qui s’engage à aller le plus loin, le plus haut, le plus fort possible et comme, chacun de nous revendique de pouvoir guérir la vie des atteintes de la mort.
Ne faudrait-il pas se souvenir qu’en ces époques qui négligeaient les milliers de morts épidémiques, on vivait moins longtemps et on mourrait chez soi. On ne s’en souvient plus, car à force de vivre trop longtemps, on meurt comme de vulgaires malades.
Comment déprendre la parole en période de crise ?
Dans une précédente chronique, nous nous étions interrogés sur le temps de la parole. Deux moments s’étaient distingués. Il fallait prendre la parole lors de l’un ou l’autre de ces deux moments. Idéalement, les deux, mais on sait ce qu’il en est de l’idéal. Maintenant, il est temps, d’aborder la deuxième étape de notre questionnement sur la parole. On commencera par une image.
Comparons la prise de parole à un événement historique : La prise de la Bastille par exemple. Il est d’une totale évidence qu’une fois la Bastille prise, c’est fini. On ne peut plus recommencer, à moins d’attendre deux ou trois cents ans, en espérant qu’elle sera toujours debout. Rome par exemple à été prise à de multiples reprises, mais jamais trois fois dans une semaine. Trois fois par millénaire, à la rigueur.
Donc, en période de crise, une fois qu’on a pris la parole, c’est comme pour la Bastille, on ne peut pas recommencer trop vite : il n’y a plus grand-chose à dire et de moins en moins de gens pour écouter.
Résumons-nous : nous avons pris la Bastille , nous avons choisi le bon timing. Notre prise de parole est arrivée au bon moment. Mais voilà le fond du fond du questionnement : et maintenant que faisons-nous ? Ludwig Wittgenstein, philosophe autrichien a su, avec la clarté qui illumine son œuvre, résumer la réponse à ce questionnement :
« Ce dont on ne peut parler, il faut le taire »
Ne pensons pas là, à un de ces paradoxes faciles qu’aiment à égrener les philosophes facétieux : LW ne l’était pas. Ce qui est dit là, est très exactement ce qu’on observe au moment où ces lignes sont écrites. La Bastille étant prise, il faut ne pas s’y attarder. Ce qui, pour la parole, signifie qu’il faut se taire.
Mais s’il faut se taire, que tait-on ? On doit taire ce qu’on a dit. Par exemple, on a dit : « il n’y a pas de masques » afin de démasquer ainsi le gouvernement. Il faut maintenant ne plus en parler. (on a raison, parce que, comme la cavalerie dans les westerns américains, ils finissent pas arriver !). On a dit, « Au lieu de lutter contre le virus chinois, on fait taire Raoult pour protéger les mandarins ». Il vaut mieux laisser tomber : on a vu Raoult et Macron en virée à Marseille, bras dessus, bras dessous en train de chanter la « tonkinoise ». On a dit : « et les vieux, on ne compte pas les vieux qui meurent par dizaines de milliers enfermés dans des établissements sanitentiaires. Ne libère-t-on pas les jeunes enfermés dans des taudis pénitentiaires ? ». Une fois dit, il est préférable de ne pas le répéter : on pourrait vous prendre au mot et vous refiler une grand-mère avec, en prime, un jeune délinquant libéré.
Donc, une fois la parole prise et consommée, il faut s’en déprendre, sachant, et c’est très important, que se déprendre de la parole suppose de se taire. On détournera la célèbre sentence :
« Avant que de reparler commence par te taire »
De fait, les sages et les communiquant, se sont tus. Bien sûr, on a toujours le collectif de médecins de basse-bretagne qui « dénonce l’incurie gouvernementales ». En province et en crise, c’est assez fréquent, les nouvelles du front se répandent lentement. On aura aussi quelques remarques, une tribune libre en général, écrite par une femme de la diversité, troisième génération, dénonçant le « colonialisme souterrain qui se niche même dans les masques : ils sont tous blancs ».
La prise de la bastille illustrait le phénomène en action, les mouvements de la mer, l’illustreront en désaction : le reflux. La mer se retire, la marée est basse, les flots sont fatigués, la mer est redevenue sereine.
Reviendra-t-il, le temps de la parole ? Mélenchon postillonnera à nouveau. Martinez lancera des mots d’ordre de grève.
Pourtant, sera-ce vraiment de la pure prise de parole ou du bruit qui nous reviendra avec les pétarades des scooters et les avions qui décollent ?
Coronavirus: gentils Allemands disciplinés contre vilains Français désordonnés

« Quand je me regarde je me désole, quand je me compare, je me console ». La sagesse française a de ces formules qui réconfortent le désespéré et lui donnent à voir que l’horizon est une manifestation amicale de la nature et non la « ligne imaginaire qui recule au fur et à mesure qu’on avance » des fâcheux.
Aujourd’hui, nous assistons impuissants aux progrès du mal et à l’effondrement des vieilles formules. Aujourd’hui « Quand je me compare, je me désole ».
En dehors des Italiens, et même des Espagnols et des Anglais peut-être ou des Américains; en dehors des Indiens , en dehors des Africains, donc en dehors de pays retardataires sur le plan éco-technologique et que nous surpassons, peut-être temporairement, reconnaissons que les comparaisons ne sont pas flatteuses.
Commençons par le pire : Les Allemands. C’est en réalité commencer par les meilleurs, car, justement avec un nombre de malades plus élevé que nous, ils ont un nombre inférieur de morts. La différence avec la France se nomme : organisation. Les Allemands sont un peuple organisé. Donc discipliné. En général, ils se débrouillent pour maîtriser l’aléa où qu’il soit, d’où qu’il vienne. Ils savent créer des logiciels qui truquent les émissions nocives. C'est un exemple.
Alors, Messieurs les Français, où est-elle « l’insolente nation » ?
Et les chiffres s’égrènent qui dénoncent l’infériorité française. N’a-t-on pas délocalisé quelques malades français vers les hôpitaux allemands qui étaient en manque de victimes du virus ?
Mais ces chiffres qui s’égrènent commencent à m’étonner. Et si les Allemands trichaient encore. J’ai envie de dire : « comme d’habitude » ?
Les morts du coronavirus: 3800, disent les statisticiens allemands… c’est-à-dire à peu près l’inverse de ce que les chiffres enseignent sur la démographie et la répartition des richesses allemandes. Une particularité des statistiques allemandes: mieux conçues elles seraient plus fines et raconteraient de belles histoires ?
Résumons : le nombre de vieux dans la population allemande donne le taux le plus élevé du monde, devant l’Italie et le Japon ! Ils sont environ 20 millions âgés de plus de 65 ans, contre 13 millions en France…. Il meurt en Allemagne, chaque année, 900 000 personnes, contre 600 000 en France. En moyenne, un ancien actif allemand reçoit 1 100 € brut par mois contre 1 370 € en France. La proportion de vieux en dessous du seuil minimum de pauvreté est beaucoup plus élevé qu’en France: d’après les données d’Eurostat, en 2017, le taux de pauvreté des plus de 65 ans était de 17 % en Allemagne, contre 7,8 % en France.
Conclusion : la catégorie la plus vulnérable de la population allemande enregistre le plus faible taux européen de mortalité liée au coronavirus… sachant que celui-ci tue massivement les plus vieux… ailleurs qu’en Allemagne.
Nos amis allemands nous referaient-ils le coup des bagnoles roulant au diesel ?
Dans les temps de crise quand prendre la parole ?
La parole d’un académicien… mieux, la parole d’une académie, ne vole pas. Elle reste. Elle n’est pas simplement dite, elle s’inscrit dans le marbre. Souvenons-nous que les plus belles paroles furent écrites : « passant, va dire à Sparte… ».
Aujourd’hui, en pleine crise. En pleine crise qui semblerait perdre en intensité. C’est-à-dire à un moment audible. Un moment où le cerveau se remet à fonctionner après avoir été trop longtemps confiné. En pleine crise qui tournerait bien, on voit les prises de paroles se multiplier.
Quand on y pense autrement que de façon amusante ou légère, il faut reconnaître qu’il est deux périodes de temps qu’il ne faut pas rater si on veut prendre la parole. Idéalement, il faudrait se positionner sur chacune d’entre elles. Mais, ce serait comme demander au trader de n’acheter que lorsqu’on est au plus bas et de ne vendre qu’au plus haut. Tout le monde sait que c’est de l’ordre de l’impossible ou de l’escroquerie.
Donc, il est deux moments ouverts à la prise de parole, pas plus. Si on veut que le marbre soit gravé, il ne faut pas rater l’un ou l’autre de ces moments. Par exemple : l’appel du 18 juin. Il résonne à la fin du premier moment. Tout est perdu. La catastrophe est arrivée. Personne ne s’y attendait. Il y avait bien un risque de petite catastrophe, mais pas ça, cette catastrophe absolue. Maintenant qu’elle est là devant le nez de tout le monde, irréfutable, indiscutable, indicible, il est temps de prendre la parole.
A l’opposé, on peut prendre la parole au moment où la catastrophe aborde son déclin. On en a eu récemment un bel exemple avec une récente déclaration de M. Baroin. Homme à la parole rare, sa prise de parole, avait nécessairement un sens fort et c’était « le moment ». La crise est encore là. Mais elle n’y sera plus longtemps. Parler au bon moment, c’est laisser à penser que, pareil à l’étalon dompté qui plie un genou devant son maître, l'évènement recule devant les mots qu’on lui lance, à ce moment-là.
Deux moments essentiels qui se situent l’un, quand tout paraît sans espoirs aux désespérés et l’autre, quand l’aube pointe chassant l’obscurité et les bêtes sauvages qu’elle protège. Parler, dans le premier cas, c’est se dresser contre le cygne noir, parler dans le second cas, c’est paver le chemin des Grâces.
Ce sont des clefs qu’on donne au lecteur. En ces temps difficiles, pour comprendre son propos, il est important de définir précisément dans quel moment pense se situer un locuteur. Récemment, on a noté une prise de parole de M. Mélenchon. Homme à la parole abondante, il s’était fait rare. Et le voilà qui se met à parler. Je n’ai pas trop bien compris ce qu’il racontait pour une raison simple : il était manifeste qu’il ne savait pas dans quelle période il se positionnait. Etait-il en train d’expliquer pourquoi la catastrophe venait d’exploser et que c’était la faute des autres ou bien se voyait-il en dresseur de catastrophe, parlant pour se montrer en train de la dompter.
Notre exemple initial est critique : l’Académie de Médecine s’est tue depuis le début de la « crise », il en est de la déprise de parole comme de la prise, c’est un choix. Or, on l’a montré, le temps de ce choix est déterminant. Aujourd’hui l’Académie se prononce, au moment où de bons signes sont annoncés. Il était donc temps de prendre la parole.
Le locuteur sot sera celui qui, la catastrophe s’achevant, voudra en ponctuer la retraite en prenant la parole… pour dire quoi ? Rien qui vaille d’être entendu puisqu’il n’y aura plus rien à dire.
Comprendre le Métavers en 20 questions

Il vous suffira de tendre la main, vers les librairies du net,
Babelio, Amazon, Fnac, books.google, BOD librairie et l'éditeur: Arnaud Franel Editions
Quelques ouvrages de Pascal Ordonneau
Panthéon au Carré est disponible aux éditions de la Route de la Soie.
Promotion est disponible chez Numeriklivre et dans toutes les librairies "digitales"
Au Pays de l'Eau et des Dieux est disponible chez Jacques Flament Editeur ainsi que
La Désillusion, le retour de l'Empire allemand, le Bunker et "Survivre dans un monde de Cons".
"La bataille mondiale des matières premières", "le crédit à moyen et long terme" et "Les multinationales contre les Etats" sont épuisés.
En collaboration: Institut de l'Iconomie
S'inscrire
chaque semaine "La" newsletter (tous les lundis)
et "Humeur" (tous les jeudis)
Il vous suffit de transmettre vos coordonnées "Mel" à l'adresse suivante
pordonneau@gmail.com
 Pascal Ordonneau
Pascal Ordonneau