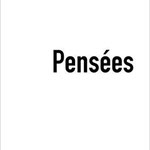Soliloques sur l'Art, novembre 2015
- Le temps d'une vidéo
- Jeunes artistes, Zou et Hanna Sidorowicz
- La routine dans l'Art
Jeunes artistes entre hier et aujourd’hui
ZOU
HANNA SIDOROWICZ
Un vernissage, mercredi dernier, avenue Bugeaud chez envie d’art. En général, je ne vais pas aux vernissages. Trop de monde, devant les œuvres qu’on vernit, ou devant le buffet, surtout devant le buffet. Appuyez-vous sur les principes, ils finissent toujours par céder. J’y suis allé. Tant pis pour la foule : je n’ai pas perdu mon temps.
Deux artistes exposent en ce moment. Il faut aller voir.
Il y a ZOU que j’ai « chroniquée » déjà à deux reprises en deux ans et c’est bien : elle a quelque chose à dire et trouve des lieux pour le clamer haut et fort. On trouvera l’adresse de ces chroniques en suivant ce lien alphabétique. C’est simple, Zou, c’est la dernière lettre ! Zou, rendre au monde ses couleurs ; Zou: l'art est arrivé parmi nous.
J’aime ce que fais Zou. Elle a trouvé un mode d’expression où l’arbre, souvent le même, se dresse et met en valeur une vie de couleurs un peu passées, de matières collées et repeintes. L’arbre énonce son ancrage dans le monde de tous les jours, le monde dit réel où il y a de la nature et des choses qui vivent. L’arbre aussi vigoureux et bienveillant, on le dira traditionnel, comme celui qu’aiment les enfants, ramures et feuillages larges et protecteurs. Il est bien au milieu des toiles, objet de la représentation et clé tout à la fois de la mise en page. Et quand il est décalé, c’est un voyage qu’il promet ou le temps à qui il faut laisser de la place pour s’exprimer. L’arbre placé dans des contextes abstraits, sombres parfois, effacés ou pâles leur donne leur sens et invite le regardeur à rêver. C’est une peinture de la tranquillité, proche du dessin parfois et du collage. Peut-être préfèrera-t-on lire ces œuvres plutôt que les regarder. Rêver, lire, Zou conduit doucement ses regardeurs. Elle les conduit bien et fermement aussi !
Et puis il y a Hanna SIDOROWICZ. Sa présence explique l’intitulé de la chronique. Zou, je l’ai dit, c’est une rencontre d’il y a deux ans. Hanna Sidorowicz, c’est une rencontre d’il y a 33 ans ! Elle exposait rue de Seine. Je crois qu’elle venait d’arriver à Paris, ayant quitté sa Pologne natale. J’avais beaucoup aimé ce travail de plume, de crayons, de craie et d’encres en toutes sortes et de toutes les couleurs qui trace son chemin sur de belles feuilles de papier marouflées sur toile. Travail grinçant. Regardant une toile d’Hanna Sidorowicz, on n’est pas dans le domaine de la vision pure, mais des sonorités, des bruits. Déchirements du papier, grincement de la plume, grattement des crayons qui donnent des lignes, des réseaux, un peu de barbelé, des épines et des saignements. Exactement à l’inverse de Zou, Hanna Sidorowicz, interpelle les regardeurs et leur montre ce qu’ils n’ont pas eu envie de voir : la douleur, la souffrance, les lendemains qui ne chantent pas. On l’a compris, rien de doux ni de chaleureux. Tout est dans un cri ou au mieux un appel. L’artiste est complétement dans la ligne d’une recherche menée depuis longtemps et son style ne peut être confondu. Son évolution est nette en travaux violemment colorés de rouge, ou surprenante, perspectives lointaines, originales pour une artiste qui a préféré les a-plats. Il y a même du Kiefer, en forme de notations (perspectives 2015) et aussi une robe splendidement faite où se retrouveraient des accents de Martin Assig ou de Pizzi Canella.
Belle exposition. Des artistes à suivre.
La routine dans l’art

Pourquoi, brutalement, introduire cette idée que les artistes se fonctionnarisaient et, plutôt que de persister dans l’innovation et la recherche de nouvelles visions, se banaliseraient eux-mêmes, voire se copieraient, se répéteraient, radoteraient ou industrialiseraient leurs procédés?
C’est une vieille idée que je suis depuis longtemps. Le déclencheur ? Je crois que ce sont les aventures de Chirico. Rappelez-vous. Pas convaincu par son génie surréaliste, il vire maniériste et s’autopeinturlure, en chevalier, en notable, en n’importe quoi dans le grand style d’avant toutes les révolutions picturales. Puis, comme il faut bien manger, il accepte de répéter, 20 ans après les peintures qu’il en était venu à détester!
Et aussi, une exposition récente, belle mais un peu dure pour l’artiste : Vigée-Lebrun. On peut expliquer que c’est de la peinture de cour, on peut dire qu’elle portraiturait pour flatter ou qu’en portraiturant elle flattait, on ne peut pas dire qu’elle peignait mal. Elle a commis une peinture heureuse pour des gens heureux à une époque si heureuse que Talleyrand, pensant à l’Ancien Régime, énonçait qu’il manquait l’essentiel à ceux qui ne l’avaient pas connu. Son portrait le plus accompli est sans conteste son autoportrait dit de la «Tendresse Maternelle». Et puis, avec la Révolution, elle s’enfuit et s’en va portraiturer partout en Europe. A ce stade cela devient du commerce. Et le commerce on le sait ne vaut que s’il ne perd pas son temps avec l’originalité. On ne vend bien que ce qui est connu et on ne gagne rien à changer les manières de faire qui gagnent. Résultat, elle a fabriqué de l’art, en bonne commerçante routinière et «chère!».
Et Renoir, dont quelques méchants critiques (américains) veulent qu’on le sorte des musées (du monde)? Franchement, ils n’ont pas tort! Il a renoirisé une bonne partie de sa vie, pondant des petites merveilles greuziennes à base de couleurs nacrées et de brouillards de couleurs abusivement qualifiées d’impressionnistes. C’était un impressionniste pour nouveaux riches dans le nouveau monde. Et Canaletto? Lui, c’est encore plus simple, il avait installé à Venise une petite usine à «vues de Venise». Il avait même pensé que ses clients étant largement anglais, il était préférable de rapprocher le producteur des consommateurs (faire du peer to peer avant l’heure). Lui aussi avait conçu un produit «vendeur» et une routine de fabrication et de commercialisation.
Et les exemples de se multiplier! Qui se souvient du talent incroyable de Van Dongen, fauve exceptionnel parmi les fauves devenu peintre de nymphettes d’après nature et de dames du XVIème arrondissement d’après photos.
D’où m’est venue cette impression qu’à partir d’un certain âge ou de leur ancienneté dans la profession, ils se contentent de vendre des trucs qui marchent? Ils auraient rencontré leur marchés, leurs acheteurs, leurs niveaux de prix et, dotés d’un sens marketing inné, se caleraient sur leurs exigences et requêtes.
Quand on veut faire de l’argent il ne faut pas surprendre le chaland mais lui vendre ce qu’il attend. La routine de l’art, c’est le fric.
Le temps d’une vidéo

Je reviens sur la présentation très intéressante du travail d’Erwin Olaf par la Galerie Rabouan-moussion « Waiting ». Je l’avais commentée dans une chronique « l’essentiel est visible pour les yeux » qu’on pourra retrouver à l’adresse suivante.
Parmi les images les plus frappantes, celles animées de deux vidéos.
Ces deux vidéos n’en sont qu’une en ce sens qu’il s’agit de la même scène filmée sous deux angles différents. Une des deux vidéos est prise, très près de « l’actrice » et presque frontalement. L’autre en est éloignée et la capte en biais.
Il ne se passe rien.
Le personnage attend. On présume qu’il attend. On ne sait pas qui. C’est une femme, chinoise, qu’on devine très grande. Le cadre est totalement impersonnel. Le lobby d’un hôtel ou le bar. On devine d’autres personnages. Ils ne jouent pas même un rôle d’appoint. Ils ne bougent pas. Seul personnage en mouvements clairement perceptibles, une serveuse va et vient auprès de cette femme chinoise qui attend.
Peut-être n’attend-elle personne. Elle ne regarde jamais sa montre. Peut-être n’a-t-elle pas de rendez-vous. Quand on a un rendez-vous, quand la personne que vous attendez n’arrive pas, en général, on regarde sa montre. Pour vérifier l’heure. Pour calculer les chances d’arrivée. Pour s’assurer qu’il n’est peut-être pas si tard. Que le retard n’est pas si grand.
Elle regarde souvent devant elle, c’est-à-dire rien. Les vitres de ce lobby ou bar, laissent deviner un univers comme à Singapour ou à Taipei en grands immeubles, en tours presqu’effacées dans une atmosphère brouillardeuse et blanchâtre. Il n’y a rien à y voir. D’ailleurs, elle ne les regarde pas. Elle observe plus souvent ses mains que ce qui l’entoure. Elle bouge ses mains, comme si, avec ses yeux, rien d’autre ne mériterait d’être mis en mouvement.
Très lentement, et pendant de longues secondes, ou minutes, je ne sais plus, elle ne bougera pas. Son visage restera immobile, aucun trait de changera, aucune émotion ne filtrera. Pendant de longues minutes, une caméra montrera un visage lisse et soyeux, des yeux fendus, iris noir sur pupille noire. Cette immobilité a son pendant dans l’autre vidéo, plus forte encore, puisque la prise de vue est plus éloignée.
Et puis, quelques mouvements. Les doigts qui se délacent et s’allongent, les yeux penchés vers les doigts qui les observent. Et tout ceci dure des minutes ou des secondes, de longues secondes qui auraient valeur de minutes ou de quarts d’heures.
Les deux vidéos ont été placées dans un espace en angle aigu. Ainsi le spectateur peut aller de l’une à l’autre au gré de la rêverie qui le saisit progressivement, lentement, très lentement, comme une fascination, un songe qui se prolonge, un ralenti de mouvement, de film, de musique, n’importe quel ralenti.
Pourquoi, longtemps après cette séance, ai-je pensé à certaines images, certaines scènes de «l’année dernière à Marienbad» ? La lenteur sûrement, le détachement des personnages, détachés d’une vie à la vitesse normale ? Pourquoi ai-je pensé à Bill Viola ? Tellement évident cependant que l’inverse eût été anormal.
C’est alors que j’ai eu ce sentiment très particulier d’avoir vu émerger quelque chose que je pressentais, à quoi je ne parvenais pas à donner de nom, dont la complétude m’échappait. Je n’ai jamais eu de passions pour les vidéos. Elles ont longtemps joué sur les registres les moins glorieux de l’expression artistique, le sexe, la violence, l’horreur, les clowneries sinistres, la bidouille audio-visuelle, et les plats de spaghettis à base de couleurs spicy et de jus de tomate mimant l’hémoglobine. En d’autres termes, cela ne m’intéressait pas. J’imaginais ces écrans accrochés à un mur, à la place d’une télé à l’écran version feuille de cigarettes. J’essayais de me faire appuyer sur des boutons de télécommande pour voir déferler des vidéasteries plus mal fagotées qu’artistement construites.
Non, je n’y arrivais pas.
Sauf tout récemment et dans un esprit aux antipodes des excitations vidéos superflues. Sauf quand j’ai vu les vidéos d’Erwin Olaf.
Je sais ce que j’attends d’un vidéaste. Je sais l’art que je pressens. Il faut se lancer directement : j’attends, comme ce que j’ai vu dans les vidéos de Viola ou d’Olaf, que le temps se déroule lentement, comme s’érigerait un baobab, comme s’élèverait une montagne ou se sculpterait un canyon. A l’inverse de ce qu’on prétend du monde d’aujourd’hui, rompre avec l’impératif du «Vite» ou «du tout de suite», de «l’instantané» ou de la vitesse de la lumière.
Rompre avec les tentatives heureuses ou malheureuses des peintres de la vitesse, de la technologie ou du paradoxe, qui miment la vitesse, ou la dénaturent en la figeant en poses suggestives. On entend leurs œuvres crier aux regardeurs des phrases ridicules : «Et pourtant, je me meus». On entend un nu dans un escalier qui demande aux regardeurs «l’ai-je bien descendu ?» confondant les multiples successifs avec le déroulement du temps, le caricaturant en une pose d’opérette.
Le temps peut nous revenir dans sa plénitude quitte à prendre, s’il lui plait, des allures de ruisseau, de torrent ou de mangroves.
Je pense maintenant à un écran qui s’anime d’une émotion à vitesse tellurique. Entre deux journées, un geste simple aurait modifié une scène dans d’infimes conditions. A l’intérieur d’une semaine, la luminosité aurait changé, une nouvelle saison aurait donné de nouvelles couleurs.
Un jour, je me serais aperçu que ce sont des années qui ont passé devant mes yeux. Un jour, je m’apercevrais qu’à la possibilité technique d’un retour en arrière, pour mieux voir, pour chercher des références et des repères, s’opposerait le temps dans son épaisseur et sa gravité. Retourner en arrière ? Remonter le cours du fleuve ou les sinuosités d’un sentier ? Pour ensuite repartir ? L’œuvre ainsi conçue montrerait que le choix existe aussi de perdre son temps à penser au temps passé et poursuivre sa route vers les temps à venir, dans l’incertitude de ce qui surgira, dans la conviction que cette incertitude est à l’origine d’une multiplicité d’embranchements.
Inscrire le temps, le retrouver, celui-là qu’on donnait perdu pour l’éternité. Lui rendre et sa fluidité et son épaisseur. Restaurer son pouvoir sur notre esprit, le remettre au-devant de la scène, et magnifier nos sens.
C’est un programme artistique de recherche fondamentale ou un programme de recherche fondamentale artistique. Ce serait revenir sur des millénaires de représentation. Ce serait quitter les métaphores du temps que l’on arrête faute de pouvoir le montrer ou qu’on travestit à force de le jeter à la figure de spectateurs hallucinés. On retrouverait ainsi les tentatives sublimes des grands architectes et des sculpteurs, impossibles pourtant, sauf à figer le temps sous formes d’instants magiques mais immobiles.
On trouverait aussi que le temps n’est pas plus linéaire qu’un sentier de montagne, on se trouverait en face de choix à formuler, de croisées de chemins et de bifurcations imposant au spectateur le devoir d’orienter la course de l’œuvre.
Mais peut-on de nos jours retrouver la sensation du temps qui passe, qui hasarde et s’étale et se répand comme l’eau, comme le vent et les ondes dont nous sommes faits? Ne sommes-nous maintenant capables que de soutenir que "sûrement il y a un responsable, que le temps ne se déroule pas au hasard". Si cela était, mon projet serait vain. Au contraire, si on accepte de reconnaître au temps sa libre capacité à se déployer, alors, quelles belles œuvres nous seront données.
Comprendre le Métavers en 20 questions

Il vous suffira de tendre la main, vers les librairies du net,
Babelio, Amazon, Fnac, books.google, BOD librairie et l'éditeur: Arnaud Franel Editions
Quelques ouvrages de Pascal Ordonneau
Panthéon au Carré est disponible aux éditions de la Route de la Soie.
Promotion est disponible chez Numeriklivre et dans toutes les librairies "digitales"
Au Pays de l'Eau et des Dieux est disponible chez Jacques Flament Editeur ainsi que
La Désillusion, le retour de l'Empire allemand, le Bunker et "Survivre dans un monde de Cons".
"La bataille mondiale des matières premières", "le crédit à moyen et long terme" et "Les multinationales contre les Etats" sont épuisés.
En collaboration: Institut de l'Iconomie
S'inscrire
chaque semaine "La" newsletter (tous les lundis)
et "Humeur" (tous les jeudis)
Il vous suffit de transmettre vos coordonnées "Mel" à l'adresse suivante
pordonneau@gmail.com
 Pascal Ordonneau
Pascal Ordonneau